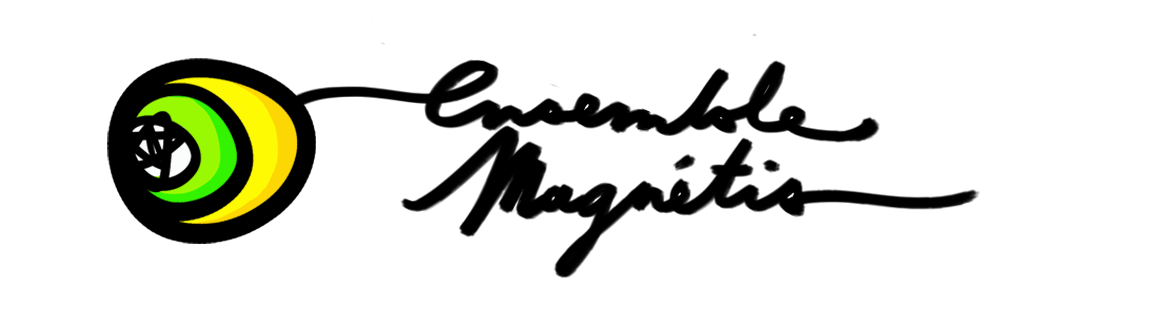Introduction du Livret Exotisme et métissage
L’exotisme (ou le folklore), par opposition à la culture musicale savante occidentale, a toujours intéressé les compositeurs. Du 16ème siècle à la fin de l’époque baroque il reste un « rêve d’ailleurs » assez vague, et surtout l’occasion d’écrire une musique très libre, allant de l’évocation d’un certain idéal (dans le Cantique des cantiques de Palestrina par exemple, notamment dans le Nigra sum) à la caricature (dans les turqueries…), et permettant toutes sortes d’effets (comme dans Les plaisirs de l’île enchantée de Lully et Molière), sans aucun lien avec les musiques des contrées évoquées.
Les marins sont depuis toujours les témoins et les passeurs de ces rêves de liberté, et il me semble intéressant dans cet esprit de métissage, de ponctuer ce programme de musique classique par des chants de marins.
Des éléments folkloriques vont être introduits au début du XVIIIème siècle dans la musique classique, notamment par les compositeurs autrichiens, mais cet intérêt pour le folklore (qui est encore en grande partie une vision très personnelle et très peu authentique des compositeurs) va prendre son essor avec le romantisme, et le désir de reconnaissance des particularismes des peuples intégrés dans les grands ensembles politiques de l’époque (Empire austro-hongrois, etc.).
Un métissage au sens propre du terme aura lieu avec Bartók, à la fois compositeur génial et ethnomusicologue, qui mettra sa technique de composition occidentale traditionnelle au service du véritable esprit de la musique populaire paysanne de tous ces peuples (et même d’Afrique du Nord), notamment dans ses Duos de violons. Avec des perspectives bien différentes et un style aux accents encore très romantiques, la Mélodie hébraïque du compositeur lituanien Joseph Achron représente elle aussi un réel métissage : celui de la culture occidentale avec la musique traditionnelle juive.
L’idée d’enrichissement mutuel que sous-entend le métissage, est à l’opposé de l’uniformisation. L’exploration d’autres cultures ou d’autres paysages ne signifie évidemment pas l’abandon de ses propres recherches. Au contraire, chaque artiste ou penseur a ses propres problèmes et centres d’intérêt, et la confrontation avec d’autres cultures les nourrit, les fait évoluer, peut entrouvrir de nouvelles voies de recherche, mais ne les dissout pas. Il s’agit bien plus d’une sorte de stimulant pour la création.
Avec les expositions coloniales, les compositeurs français de la fin du XIXème siècle vont avoir accès à des instruments et des harmonies exotiques qu’ils vont utiliser dans certaines de leurs œuvres (comme Debussy avec la musique balinaise), mais ce n’est pas cela qui les rend intéressants, même si ces éléments exogènes sont ce qu’il y a probablement de plus facilement repérable. Ce sont les structures de leurs compositions, les nouveaux agencements sonores qu’ils créent qui font leur originalité.
Dans le domaine de la peinture par exemple, Gauguin n’est pas original parce qu’il peint les paysages et les habitants des îles polynésiennes, mais parce qu’il a entrepris une recherche picturale propre, qui a d’ailleurs commencé bien avant de partir pour les îles (et à Tahiti il se tiendra informé des dernières créations artistiques européennes à travers sa lecture assidue du Mercure de France). Comme il le souligne à maintes reprises dans sa correspondance, notamment dans une lettre célèbre à sa femme, son originalité se trouve dans sa détermination à trouver ce qu’il a en lui d’unique, et à l’exprimer sans peur du jugement et des conventions de l’époque (ce qui ne va pas de soi et lui attirera le plus grand mépris de la part de la critique et des institutions culturelles officielles) :
« (…) je suis un grand artiste et je le sais. C’est parce que je le suis que j’ai tellement enduré de souffrances. Pour poursuivre ma voie, sinon je me considèrerai comme un brigand. (…) Tu me dis que j’ai tort de rester éloigné du centre artist[ique]. Non, j’ai raison, je sais depuis longtemps ce que je fais et pourquoi je le fais. Mon centre artistique est dans mon cerveau et pas ailleurs et je suis fort parce que je ne suis jamais dérouté par les autres et que je fais ce qui est en moi. (…) j’ai un but et je le poursuis toujours accumulant des documents. Il y a des transformations chaque année, c’est vrai, mais elles se suivent toujours dans le même chemin. »
Il avait déjà dénoncé dans plusieurs lettres la confusion entre ce qu’on pourrait appeler un « exotisme superficiel » et un « exotisme profond ».
Cet « exotisme superficiel » consiste à peindre un « sujet exotique » (les îles polynésiennes par exemple, des paysages d’Afrique…) qui représente une fausse nouveauté et plaira vraisemblablement à beaucoup : « Je suis un peu de l’avis de Vincent [van Gogh], l’avenir est aux peintres des tropiques qui n’ont pas encore été peints et il faut du nouveau comme motifs pour le public, stupide acheteur ».
Cette forme d’exotisme sans consistance, car s’arrêtant aux apparences les plus grossières, est déjà moquée par Montesquieu dans ses Lettres persanes : l’un des deux héros, le jeune Rica, se plaint qu’on ne fasse attention à lui que lorsqu’il sort avec ses habits persans. Habillé à l’européenne « pour voir s’il resterait encore dans [sa] physionomie quelque chose d’admirable », « libre de tous les ornements étrangers » il se voit « apprécié au plus juste » : il tombe dans un « néant affreux » et n’intéresse plus personne. Toute son identité, sa différence, est niée. Et lorsqu’on apprend par hasard qu’il est persan, il suscite bien un léger regain d’intérêt, mais c’est pour s’attirer des commentaires qui témoignent en réalité d’un refus profond d’aller à la rencontre de l’autre : « Ah ! ah ! Monsieur est Persan ? c’est une chose bien extraordinaire ! Comment peut-on être Persan ? ».
Montesquieu n’a pas inventé avec les Lettres persanes ce genre de fiction dans laquelle un observateur étranger décrit d’un œil « neuf » la société européenne, tout en permettant aux lecteurs de découvrir des mœurs étrangères. Mais contrairement à ses prédécesseurs qui se limitent au pittoresque et aux questions religieuses, et font de leur héros, par méconnaissance de l’Orient, une sorte d’abstraction (il s’agit encore une fois de cet « exotisme superficiel »), Montesquieu se documente très sérieusement sur la société persane, et surtout, propose à travers les différents thèmes qu’il aborde une autre manière de penser les relations entre les hommes et leur rapport à la nature : une philosophie qui trouvera son aboutissement dans De l’Esprit des lois. Il s’agit là d’un « exotisme intellectuel profond », un exotisme de sociologue et c’est bien cet aspect-là qui dérangera, malgré le succès éditorial des Lettres persanes.
En outre, Montesquieu met en évidence l’évolution des points de vue d’Usbek et de Rica lors de leur séjour en Europe (essentiellement à Paris), à travers leurs échanges épistolaires. Certes la culture européenne leur semble étrange de prime abord – et ils en dénoncent les travers, parfois avec beaucoup d’humour et d’autodérision comme on l’a vu avec Rica – mais elle va leur faire prendre également conscience des limites de leur propre société, et des doutes de plus en plus grands sur son organisation et sur la validité indiscutable de leur mode de vie vont naître chez ces deux personnes de bonne volonté, notamment chez Rica qui décidera finalement de ne pas retourner en Perse.
La tension que l’on sent, malgré un certain calme apparent et en effet trompeur, dès le début des Lettres persanes à propos du harem d’Usbek et de son rapport aux femmes, incompatible avec la vision de la société de Montesquieu, aboutira fatalement à la désagrégation tragique de tout un monde, de toute une conception de la vie et du bonheur. A travers son suicide bouleversant, sans aucune théâtralité mais plein d’une effroyable et juste colère envers son mari et maître Usbek, de revendication et d’amour pour son amant, Roxane met en pièce violemment tous les voiles de l’hypocrisie ainsi que la chape de plomb écœurante du harem.
Mais l’humanité et la portée universelle de son geste dépassent largement une histoire de harem qui ne nous concernerait finalement pas tant que ça. Il nous oblige à reconsidérer la portée des rapports de force entre les individus, les effets des différentes dominations (entre les sexes, du riche sur le pauvre, de l’homme instruit sur l’inculte, du maître sur l’esclave…) à l’œuvre dans la plupart des sociétés humaines, et à inventer de nouveaux modes de vie en société, de nouveaux rapports entre les hommes et les femmes, des rapports réalistes et sereins, « naturels » dira Montesquieu (le harem avec ses eunuques mutilés et ses femmes séquestrées symbolisant pour lui l’anti-nature par excellence).
De cette expérience tragique, qui emprunte les traits de l’exotisme pour mieux mettre en évidence l’aspect universel de cette réflexion, doit naître la construction d’une autre société, fondée non pas sur le rapport de force, mais sur le respect de lois justes, garantissant la liberté et l’épanouissement de chacun. Une société éclairée, qu’elle se situe en Europe ou aux antipodes. « L’exotisme profond » des Lettres persanes prenant sa source dans la reconnaissance de la pertinence du regard de l’autre bien que sa vision nous soit étrangère, et donc de la relativité de toute civilisation et des normes dans lesquelles nous vivons. Une invitation à penser autrement.
Pour revenir à la peinture et à Gauguin, « l’exotisme profond », est une manière de peindre exotique : il consiste à peindre autrement, « en sauvage », à faire « un art de papou » comme il le dit lui-même, qui lui, réellement personnel et nouveau, posera problème. Comme le rappelle Maurice Denis dans un article d’août 1890, il ne faut pas confondre le sujet et la manière de le traiter : « Il est bon de rappeler qu’une image avant d’être un cheval de bataille (…) ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. » Et Gauguin va plus loin en justifiant lors d’un entretien ses couleurs qui n’ont rien de naturel, ses « chiens rouges » et « ciels roses » :
« (…) tout dans mon œuvre est calculé, médité longuement. C’est de la musique, si vous voulez ! J’obtiens par des arrangements de lignes et de couleurs, avec le prétexte d’un sujet quelconque emprunté à la vie ou à la nature, des symphonies, des harmonies ne représentant rien d’absolument réel au sens vulgaire du mot, n’exprimant directement aucune idée, mais qui doivent faire penser comme la musique fait penser, sans le secours des idées ou des images, simplement par des affinités mystérieuses qui sont entre nos cerveaux et tels arrangements de couleurs et de lignes. »
Ces couleurs, ces lignes sont donc des supports d’idées proprement picturales. Elles ont leur cohérence en fonction d’un but artistique (comme pérenniser sur une toile des sensations, les rendre indépendantes de celui qui les a éprouvées, c’est-à-dire créer un « percept » comme dira Deleuze).
« A mon exposition de Tahiti chez Durand-Ruel (…) la foule puis la critique hurlèrent (…) Point de perspective aimée (…) L’air était étouffant comme à l’approche d’un cataclysme, etc. Probablement ignorance de la perspective, défaut de vision, incompréhension surtout des lois de la nature. (…) « Pour amuser vos enfants, envoyez-les à l’exposition de Gauguin, ils s’amuseront devant des images coloriées représentant des femelles de quadrumanes étendues sur des tapis de billard, le tout agrémenté de paroles du cru », etc. Ces gens ne comprennent donc rien (…). L’île, montagne au-dessus de l’horizon de la mer entourée d’une bande étroite de terre sur le corail. (…) Toute perspective d’éloignement serait un non-sens ; voulant suggérer une nature luxuriante et désordonnée, un soleil du tropique qui embrase tout autour de lui, il me fallait bien donner à mes personnages un cadre en accord. (…) – Mais tout cela n’existe pas ! – Oui, cela existe, comme équivalent de cette grandeur, profondeur, de ce mystère de Tahiti, quand il faut l’exprimer sur une toile d’un mètre carré. »
Tout le travail du peintre repose sur la manière de faire « tenir sa peinture toute seule », de faire en sorte que le mystère de Tahiti n’ait pas besoin de l’aide d’explications pour être ressenti en face de la toile. Là se trouvent l’art et la personnalité du peintre. Peu importe le sujet. Et c’est là qu’un élément réellement exogène, exotique, parce que réellement personnel et issu d’une recherche sans concession au goût supposé du jour, sera perçu par le public.
Gauguin écrit d’ailleurs à cette même période une lettre importante à un autre ami peintre, Emile Schuffenecker : « Un conseil, ne peignez pas trop d’après nature. L’art est une abstraction, tirez-la de la nature en rêvant devant [c’est-à-dire en la laissant nourrir notre part la plus profonde, notre propre recherche, nos propres centres d’intérêt, ce qui nous touche vraiment, en un mot notre essence, ce que nous sommes, indépendamment de nos déterminations socio-culturelles] et pensez plus à la création qui résultera. »
Ce qui est donc important selon moi dans la notion d’exotisme, c’est l’idée qu’on en a, c’est le prétexte à création qu’elle provoque. Que réveille-t-elle en nous ? « Là à Tahiti je pourrai, au silence des belles nuits tropicales, écouter la douce musique murmurante des mouvements de mon cœur en harmonie amoureuse avec les êtres mystérieux de mon entourage. »
Cet exotisme peut être d’ailleurs relativement proche de nous. Comme le fait remarquer Proust, le peuple est une chose très exotique pour les classes aisées, et inversement. Et l’Italie, pourtant si proche de la France, avait déclenché chez le narrateur encore jeune de la Recherche une rêverie tout aussi intense que ne le feraient des contrées situées aux antipodes.
« Sans doute si alors j’avais fait moi-même plus attention à ce qu’il y avait dans ma pensée quand je prononçais les mots « aller à Florence, à Parme, à Pise, à Venise », je me serais rendu compte que ce que je voyais n’étais nullement une ville, mais quelque chose d’aussi différent de tout ce que je connaissais, d’aussi délicieux, que pourrait être pour une humanité dont la vie se serait toujours écoulée dans des fins d’après-midi d’hiver, cette merveille inconnue : une matinée de printemps. »
Ces noms de ville n’ont été que des catalyseurs pour le narrateur. Ils n’ont mis en branle que ce qui était déjà en lui et lui ont donné l’occasion de l’exprimer en une création totalement personnelle, à l’image des couleurs qu’il dégage des noms de certaines villes françaises : « (…) Bayeux si haute dans sa noble dentelle rougeâtre et dont le faîte était illuminé par le vieil or de sa dernière syllabe ; Vitré dont l’accent aigu losangeait de bois noir le vitrage ancien ; (…) Coutances, cathédrale normande, que sa diphtongue finale, grasse et jaunissante couronne par une tour de beurre (…) ».
On trouve chez Baudelaire, pour qui Proust avait beaucoup d’admiration, le même type de relation ambigüe avec cette fois la femme aimée, dont il se détourne finalement bien vite pour se concentrer sur ses visions poétiques, sur un exotisme quasi mystique où le bonheur est enfin possible, comme dans Parfum exotique, La chevelure ou encore L’invitation au voyage tirés des Fleurs du mal. Elle aussi n’est qu’un catalyseur, elle ne lui permet que d’embarquer vers un ailleurs qui est en lui, et qu’il célèbre bien plus que le corps de ses différentes maîtresses.
Nous venons d’évoquer l’exotisme du point de vue géographique, mais il peut être aussi abordé du point de vue temporel.
En effet, les œuvres de l’Egypte ancienne par exemple (peintures, sculpture, monuments…) représentent un dépaysement culturel total, on sent bien ce qu’il y a d’irréductiblement étranger à notre culture dans ces manifestations de la vie artistique des Egyptiens, dans leur vision du monde et des forces qui y sont à l’œuvre. Mais selon Kandinsky, cette étrangeté, cette différence que le temps a mise en évidence, nous permet paradoxalement de mieux comprendre l’élément artistique « pur et éternel » de ces œuvres (d’où l’émotion très particulière que l’on peut ressentir à leur contact : qui peut rester indifférent face aux pyramides ou aux statues hiératiques et hypnotiques des dieux et pharaons égyptiens ?) car il n’est plus entravé par la connaissance intime de l’influence de l’époque sur l’œuvre. Elle favorise certes l’accès de l’œuvre à ses contemporains, mais la banalise aussi et les empêche en partie d’y voir clairement l’élément proprement artistique, indépendant des conventions de l’époque dont l’artiste est bien obligé de se servir d’une manière ou d’une autre.
Pour Kandinsky, la saisie par un artiste de cet élément « pur et éternel » dans ces œuvres exotiques, doit représenter pour lui un encouragement à se concentrer sur cet élément, au détriment des conventions de l’époque, à ne pas se laisser détourner de ses recherches par l’approbation ou la condamnation des courants dominants artistiques ou intellectuels. Mais les artistes ne sont pas les seuls à percevoir cet élément artistique qui nous fera dire que telle création, est « forte » ou « belle » sans que nous puissions parfois nous l’expliquer.
Gauguin nous rapporte en effet un bel exemple de l’enrichissement mutuel, du métissage culturel qui peut naître de la confrontation de deux cultures extrêmement différentes, lorsqu’on les aborde sans a priori :
« (…) je désirais depuis longtemps faire un portrait d’une voisine de vraie race tahitienne. Je le lui demandai un jour qu’elle s’était enhardie à venir regarder dans ma case des images, photographies de tableaux. Elle regardait spécialement avec intérêt la photographie de l’Olympia de Manet. Avec le peu de mots que j’avais appris dans la langue (…) je l’interrogeais. Elle me dit que cette Olympia était bien belle : je souris à cette réflexion et j’en fus ému. Elle avait le sens du beau (Ecole des Beaux-Arts qui trouve cela horrible) ».
Et inversement, Gauguin saura voir en elle, lorsqu’il fera son portrait quelques instants après, toute la beauté si particulière de cette femme :
« Peu jolie en somme comme règle européenne : belle pourtant. Tous ses traits avaient une harmonie raphaélique dans la rencontre des courbes, la bouche modelée par un sculpteur parlant toutes les langues du langage et du baiser, de la joie et de la souffrance ; cette mélancolie de l’amertume mêlée au plaisir, de la passivité résidant dans la domination. »
Mais comme nous l’avons dit, ce métissage ne signifie en aucun cas une perte d’identité. L’expérience de Claude Levi-Strauss est extrêmement significative à cet égard.
En effet, il relate sa déception au début de sa carrière de ne finalement jamais trouver au bout de ses expéditions d’hommes réellement primitifs, n’ayant subi aucune influence des civilisations modernes. Il se trouve face à un dilemme : il a conscience d’une part que les premiers explorateurs, ceux qui justement ont rencontré ces tribus et découvert leurs civilisations, n’ont eu pour elles, par un déterminisme culturel qui semblait exclure toute possibilité de communication réelle, que raillerie et dégoût et n’ont donc pas pu profiter des immenses richesses culturelles qui s’offraient à eux, et d’autre part, que l’explorateur de son époque (la première moitié du XXème siècle en l’occurrence), nourri par des textes, des dessins ou encore des objets suscitant une curiosité et un intérêt des plus vifs – et donc maintenant capable d’aller à la rencontre de ces peuples – n’aura accès qu’aux « vestiges d’une réalité disparue ».
Mais Levi-Strauss poursuit sa réflexion en imaginant un explorateur du futur qui se lamenterait de nous voir incapables de saisir les richesses encore à notre disposition, et à lui inaccessibles. Tout le secret est dans l’acquisition d’un regard profond, qui dépasse les apparences et sait interpréter les signes qui s’offrent à lui, et donc ce qu’ils cachent d’irréductiblement authentique et personnel :
« On apprend aux jeunes ethnographes que les indigènes redoutent de laisser capter leur image par la photographie et qu’il convient de pallier leur crainte et d’indemniser ce qu’ils considèrent comme un risque, en leur faisant un cadeau, sous forme d’objet ou d’argent. Les Caduveo [une tribu brésilienne] avaient perfectionné le système : non seulement ils exigeaient d’être payés pour se laisser photographier, mais encore ils m’obligeaient à les photographier pour que je les paye; il ne se passait guère de jour sans qu’une femme se présentât à moi dans un extraordinaire attirail et m’imposât (…) de lui rendre l’hommage d’un déclic suivi de quelques milreis [la monnaie brésilienne de l’époque]. (…) Pourtant, c’eût été de la bien mauvaise ethnographie que de résister à ce manège, ou même de le considérer comme une preuve de décadence ou de mercantilisme. Car sous une forme transposée, réapparaissaient ainsi des traits spécifiques de la société indigène : indépendance et autorité des femmes de haute naissance; ostentation devant l’étranger, et revendication de l’hommage du commun. La tenue pouvait être fantaisiste ou improvisée : la conduite qui l’inspirait conservait toute sa signification; il m’appartenait de la rétablir dans le contexte des institutions traditionnelles. »
L’art de ces tribus par exemple a certes subi des influences européennes, il y a bien eu métissage, mais n’a, lui non plus, en aucun cas perdu ses propres caractéristiques qui continuent à guider leurs créations, notamment leurs peintures corporelles. Levi-Strauss explique que de nombreux motifs (en forme de spirales, de barres…) utilisés par ces tribus rappellent l’art baroque espagnol (fers forgés, stucs), et que les indigènes se sont bien appropriés certains thèmes européens : des témoignages du milieu du XIXème siècle rapportent même que les hommes d’une tribu, les Mbaya, après avoir aperçu un vaisseau de guerre européen, s’étaient fait dessiner des ancres sur le corps, et même, pour l’un d’entre eux, tout un uniforme d’officier! Cela prouve seulement pour l’ethnographe, que les Mbaya étaient très curieux et observateurs, et qu’ils avaient acquis une très grande maîtrise de l’art du dessin corporel. Pour Levi-Strauss, les véritables caractéristiques de cet art ne se situent pas là :
« Quand on étudie les dessins (…), une constatation s’impose : leur originalité ne tient pas aux motifs élémentaires, qui sont assez simples (…) : elle résulte de la façon dont ces motifs sont combinés entre eux, elle se place au niveau du résultat, de l’œuvre achevée. Or les procédés de composition sont si raffinés et systématiques qu’ils dépassent de loin les suggestions correspondantes que l’art européen du temps de la Renaissance aurait pu fournir aux Indiens. Quel que soit le point de départ, ce développement exceptionnel ne peut donc s’expliquer que par des raisons qui lui sont propres. »
Il poursuit son raisonnement par une analyse approfondie et fascinante des ressorts extrêmement complexes qui sont à l’œuvre dans cet art tout en opposition de plans, de symétries et d’asymétries, de lignes et de surfaces…, et qui met en jeu toute une vision de l’univers et des hommes, ainsi que de leur rapport au monde et entre eux, qu’il serait bien sûr trop long de détailler ici.
Pour revenir à l’exotisme dont l’éloignement temporel pare les créations humaines, on peut penser, plus proches de nous, aux œuvres musicales savantes des XIIIème et XIVème siècles par exemple, qui, dans notre environnement où la musique tonale et ses codes sont omniprésents, ne vont pas de soi et demandent parfois un véritable effort d’ouverture émotionnelle pour être appréciées. Même la musique contrapuntique du XVIème siècle, dont certaines techniques de composition vont être exploitées par des compositeurs (notamment le travail d’imitation des voix) qui ne posent – bien au contraire – aucun problème d’écoute aujourd’hui (que ce soit Bach ou Chostakovitch), garde une part d’étrangeté, d’exotisme pour nos oreilles. Elles n’en a peut-être que plus de mystère, et exige de l’interprète d’aujourd’hui un acte de recréation extrêmement enrichissant. Encore une fois, il s’agit de trouver ce qu’éveille en nous la différence, l’exotisme, qu’il soit géographique, culturel ou encore temporel. Quel potentiel de création est libéré, qu’il y ait métissage (appropriation d’éléments d’une autre culture comme matériel constitutif de l’œuvre) ou non ?
C’est de cette création qu’il sera question à travers la musique de compositeurs aussi différents que Palestrina ou Bartók.